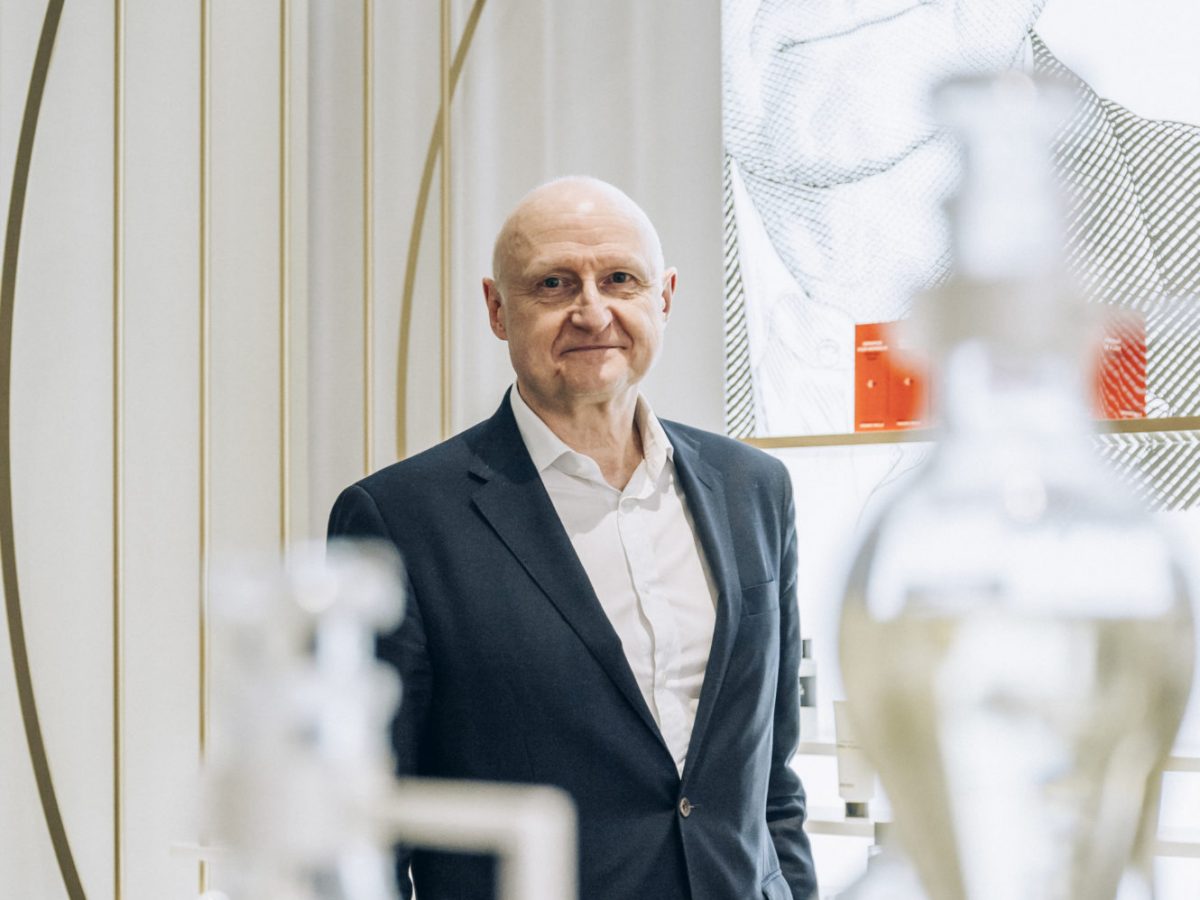La maison de composition IFF forme ses jeunes recrues en les plaçant sous l’égide d’un ou de plusieurs créateurs expérimentés. Parmi eux, un enseignant de taille : Dominique Ropion. À l’occasion de la Paris Perfume Week, le parfumeur reviendra sur son parcours légendaire, et sur l’attachement qu’il porte à la transmission.
Sa « parfumographie » donne le vertige. D’Amor Amor à Portrait of a Lady, du duo Kenzo Jungle à Bois d’orange, Dominique Ropion compose avec le même enthousiasme et le même talent blockbusters et sillages d’auteur, depuis plus de trente ans. Souvent décrit comme un artiste visionnaire, il est avant tout un artisan travailleur… qui sait conjuguer rigueur et humour. Rencontre.
Vous avez traversé l’enfance guidé par le bout de votre nez. Quand avez-vous rencontré votre odorat ?
La dimension odorante du monde m’a toujours attiré. J’ai grandi à Paris, mais mes premiers souvenirs olfactifs se situent à Chamonix, où l’on m’a envoyé respirer le bon air pendant quelques mois, quand j’avais 6 ans. Je me rappelle des guimauves à la fleur d’oranger et des entremets au citron qu’on mangeait dans le centre où j’étais hébergé.
Est-ce là que quelque chose s’est éveillé chez vous ?
C’est difficile à dire, mais je crois que cette curiosité était déjà là. Enfant, je sentais tout ce qui me tombait sous la main : jouets, peluches, poupées, petits soldats en plastique… À chaque rentrée des classes, j’adorais retrouver l’odeur particulière de la cour de l’école : un mélange d’arbres et de buissons, une odeur un peu verte, pas triste mais légèrement nostalgique. J’aimais aussi le parfum des livres, ceux de l’encre, de la colle Cléopâtre, des bonbons que je mangeais à la sortie… Je crois que ce genre d’odeurs nous habite tous. On en est plus ou moins conscient, peut-être.
Le parfum vous intéressait-il déjà ?
Oui, mais comme n’importe quel autre objet odorant. Il faut reconnaître que j’étais privilégié, parce que ma maman travaillait chez Roure, d’où elle rapportait des parfums que je sentais régulièrement : L’Air du temps, Rive gauche, Calandre, Opium… Cela a sûrement enrichi mon goût pour les odeurs. Mais je ne recherchais pas cette curiosité, c’était un état de fait. Un truc instinctif, presque animal : quand quelqu’un me serrait la main, je sentais ma main après – ce qui d’ailleurs n’est pas très poli, je me faisais souvent réprimander ! L’odeur, c’est un rapport physique au monde auquel on ne peut pas échapper, ne serait-ce que par la nourriture. Ce côté palpable me plaît.
Vous souvenez-vous du moment où vous avez transformé cet odorat en outil professionnel ?
Je suis arrivé dans le métier en naïf, vraiment ! Comme je suis citadin de naissance, la plupart de mes références olfactives étaient urbaines : l’odeur du métro, que j’aimais beaucoup, celles de l’asphalte, de certaines rues, des préaux d’école et des squares… Bien sûr, je connaissais la campagne, la mer ou la montagne, mais je n’avais pas des références qui étaient très communes pour beaucoup de Grassois avec qui j’ai fait mes études : la rose, la tubéreuse, la lavande, le jasmin… Ma rose à moi, c’était celle des fleuristes, pas celle des champs. Ma fleur d’oranger, c’était la guimauve de Chamonix ! Et l’ylang-ylang, c’est drôle, je l’associais au métro. J’ai compris bien plus tard pourquoi : il y a dans cette fleur des notes crésoliques, qu’on retrouve dans certains produits utilisés à l’époque pour nettoyer le métro. Ça peut paraître réducteur, mais c’est pour dire à quel point les références que l’on a pour analyser une odeur, pour s’en souvenir, sont personnelles. Lors de ma formation à Grasse, j’ai découvert la méthode d’apprentissage de Jean Carles. On commence par sentir et mémoriser des matières premières – naturelles et synthétiques – classées dans des tableaux par famille olfactive et par contraste. Ça n’en a pas l’air comme ça, mais c’est très difficile ! Le seul moyen mnémotechnique, c’est de noter dans un cahier à quoi chacune d’elles te fait penser.
En tant que maître parfumeur, vous avez un rôle important de transmission au sein d’IFF. Comment abordez-vous cette mission ?
C’est un rôle que j’ai eu très tôt, car déjà chez Roure j’ai formé Calice Becker, puis chez Florasynth, Émilie Coppermann. J’ai aussi donné des cours pendant une dizaine d’années à l’Isipca. Chez IFF, j’ai mis au point la méthode d’apprentissage de notre école interne, avec pour « cobaye » Fanny Bal, qui m’a beaucoup aidé car c’est un travail colossal. Je me suis appuyé sur ce qu’avait fait Jean Carles, qui lui-même avait formalisé une méthode qu’on lui avait transmise. J’aime l’idée d’être un passeur. Transmettre m’a toujours plu, sûrement parce que ça oblige à formuler, à organiser les choses. Et puis je trouve très enrichissant ce contact avec la jeunesse montante : ça permet de voir les problèmes sur lesquels ils butent – auxquels on n’a pas toujours immédiatement la solution, d’ailleurs.
Quelles sont, selon vous, les choses les plus importantes à transmettre à un jeune parfumeur ?
Avec le recul, il me semble que les seules qu’on peut vraiment transmettre, c’est le travail, une rigueur obsessionnelle. Des trucs pas très fun ! Et puis l’étude des grands classiques, qui est indispensable. Il faut sans cesse revoir L’Heure bleue, No 5, Shalimar… Alors je les sens régulièrement avec mes étudiants. Finalement, je dirais qu’on peut communiquer une passion et donner des outils qui fonctionnent, mais pas grand-chose de plus.
Retrouvez Dominique Ropion et son apprentie parfumeuse Éléonore Oyane-Nang sur la scène Smell Talks le 22 mars à 18h pour une Masterclass exclusive, accessible aux visiteurs munis d’un billet Paris Perfume Week.
- Notre pass livestream vous permet également de visionner cette Masterclass en direct et en ligne
- Cliquez ici pour accéder à la billetterie du livestream !
- Dominique Ropion dédicacera la nouvelle version augmentée de son ouvrage Aphorismes d’un parfumeur, paru aux éditions Nez.
Cet entretien a été mené par Sarah Bouasse. Retrouvez-le dans son intégralité dans la revue Nez #10 – Du nez à la bouche